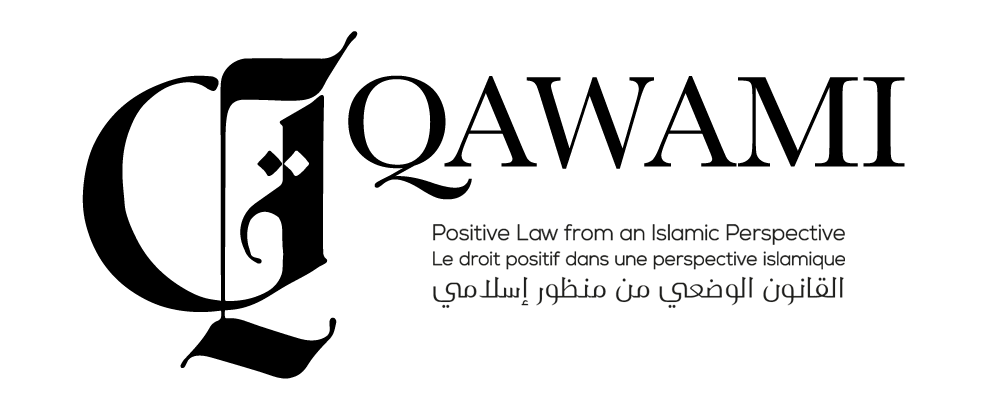Histoire politique et juridique du pays :
La Tunisie a connu divers types d’organisation politique depuis l’époque antique. Les phéniciens y fondent Carthage, dont l’influence s’étendra à une grande partie de la Méditerranée occidentale entre 814 et 146 av. JC. Le territoire est par la suite annexé par Rome, et devient une partie de la province d’Afrique proconsulaire. Au Ve siècle, il tombe aux mains des Vandales qui y fondent un royaume en 435, puis est reconquis par les Byzantins un siècle plus tard.
Ce territoire est devenu majoritairement musulman suite aux conquêtes arabes, qui ont débuté à la moitié du VIIe siècle. En 670, Uqba Ibn Nafiy fonde Kairouan, qui devient la première cité musulmane du Maghreb. Ces conquêtes se sont terminées avec la chute de Carthage en 698. Durant cette période, la majorité des berbères locaux se convertissent à l’Islam et diverses dynasties vont contrôler ce territoire, comme les Aghlabides (800-909), les Fatimides (910-972) ou encore les Zirides (972-1148). Lors du règne de ces derniers, une migration importante des tribus arabes de Bani Hilal viendra changer durablement la donne démographique du pays.
Ces dynasties vont se succéder jusqu’à la seconde moitié du XIVe siècle, lorsque la dynastie Hafside (1229-1574) va s’écrouler face aux invasions et défaites militaires. Cela marquera le début des conflits entre les Ottomans et les Espagnols pour contrôler certains territoires du Maghreb actuel. Ce conflit se terminera par la mise en place de la Régence de Tunis par les Ottomans en 1574.
Les « Beys » de Tunis sous les dynasties des Muradites (1613-1702) et des Husseinites (1705-1957) vont s’émanciper progressivement de l’Empire Ottoman à partir du XVIIe siècle, ce qui leur donnera une indépendance de fait, qu’ils conserveront jusqu’au Protectorat français. Ce dernier sera établi suite à l’endettement de la Tunisie auprès des puissances européennes, par le traité du Bardo, signé le 12 mai 1881 et surtout par les conventions de La Marsa signées le 8 juin 1883.
Alors que le traité du Bardo prévoit l’occupation militaire par l’armée française de quelques points du territoire tunisien principalement situés aux frontières et sur le littoral ainsi que le transfert à la France des compétences en matière de politique extérieure, les conventions de La Marsa obligent le « Bey » à procéder aux réformes administratives, judiciaires et financières décidées par la France. Une grande partie de l’organisation administrative est alors réformée, même si à la différence de l’Algérie, l’institution beylicale et l’administration locale sont conservées afin de servir de relais entre le nouveau pouvoir et la population.
La Tunisie obtient son indépendance le 20 mars 1956. La monarchie des Husseinites est abolie le 25 juillet 1957 et le pays adopte un régime républicain sous la conduite du mouvement nationaliste. Celui-ci est dirigé par le parti unique du « Néo-Destour ». Un des principaux leaders nationalistes, l’avocat Habib Bourguiba devient le premier Président de la nouvelle république tunisienne. Il mène une politique autoritaire inspirée, sur le plan économique d’abord par une forme de socialisme tempéré puis par un libéralisme affirmé, peu respectueuse des libertés publiques ; l’opposition politique de gauche puis celle issue du mouvement islamiste étant soient instrumentalisées, soit muselées.
Cette politique est également basée sur une sécularisation autoritaire et une marginalisation, voire un contrôle des notabilités religieuses, et plus largement de toute expression religieuse au sein de la société. C’est ainsi qu’est adopté un code du statut personnel abolissant la polygamie, la répudiation unilatérale de l’épouse par son mari, la contrainte matrimoniale (le jabr), et réformant, à la marge, le droit successoral qui continue cependant d’accorder une part supérieure au fils. Sont également supprimés les biens de mainmorte (habûs), dont les produits constituaient une grande partie des ressources des hommes de religion et leur intégration dans le domaine public, les juridictions religieuses musulmanes (et juives) dont les attributions sont transférées aux tribunaux ordinaires ; l’adoption bien qu’interdite par le droit musulman est autorisée.
La prestigieuse université religieuse de la Zîtûna est démantelée puis remplacée par une simple faculté de théologie ; les écoles coraniques sont supprimées, les ministres du culte sont fonctionnarisés. La fonction de muftî de la République, nommé directement par le président de la République et chargé de délivrer des fatâwâ (avis religieux) officielles, est créée.
Après une longue dérive autoritaire et prévaricatrice accentuée par une détérioration de son état de santé, Habib Bourguiba est déposé le 7 novembre 1987 par son Premier ministre, le Général Zine el Abidine Ben Ali. Celui-ci instaure tout d’abord une timide démocratisation par la rédaction d’un « Pacte National », signé par la plupart des formations d’opposition. Se prévalant d’être à la fois le garant de la religion et de la modernité, il prend différentes mesures destinées à revivifier certains symboles de l’islam (la diffusion radiotélévisée de l’adhân (l’appel aux cinq prièresquotidiennes), la prise en compte du calendrier lunaire plutôt que du calcul astronomique pour fixer la date des fêtes religieuses et du début du ramadân, l’accomplissement par le président de la ‘umra (le « petit » pèlerinage aux Lieux Saints de l’islam en Arabie Saoudite) et création d’une nouvelle université de la Zītūna).
Alors même que le régime avait permis aux candidats appartenant à l’opposition tant séculariste qu’islamiste de se présenter aux élections et devant le succès de ceux soutenus par le Mouvement de la Renaissance (ḥarakaal-naḥḍa), il est décidé en 1989 d’interdire les formations politiques au référentiel religieux, incluant Ennahda. En 1991, plusieurs centaines de ses membres sont poursuivis et incarcérés, une grande partie de ses militants et ses principaux dirigeants étant poussés à l’exil à l’étranger où ils côtoient ceux d’autres formations politiques ou associatives opposées au régime, scellant avec certaines d’entre-elles des alliances.
L’accentuation de la surveillance et de la répression policière à l’égard de toute forme d’opposition, les difficultés économiques croissantes, les inégalités régionales de développement, la montée des dissidences avec notamment la mobilisation en 2008 des mineurs du bassin minier de Gafsa, la conjonction des oppositions islamiste et séculariste et le développement d’une importante corruption dans l’entourage du Président affaiblissent le régime. La tentative d’immolation sur la voie publique d’un vendeur de légumes, Mohammed Bouazizi à Sidi Bouzid, une ville des régions déshéritées du centre du pays, entraine des émeutes dans l’ensemble du pays qui provoquent le 14 janvier 2011 la fuite de Zine el Abidine Ben Ali en Arabie Saoudite. Cette révolution marque l’histoire récente de la Tunisie et du monde arabe, plusieurs autres pays connaissant des mouvements de contestation populaire (les « printemps arabes »), aboutissant à la chute de dirigeants au pouvoir depuis des décennies.
A la suite de la révolution de 2011 et fort de son aura de principale force politique d’opposition au régime de Zine el Abidine Ben Ali, Ennaḥḍa accède au pouvoir, allié à deux autres formations politiques de centre gauche. Confirmant les positions prises lors de son exil à l’étranger, avec lesquelles elle avait déjà tissé des alliances, Ennaḥḍa se prononce pour la compatibilité entre l’islam et la démocratie et fait savoir que les dispositions du code du statut personnel en faveur des droits des femmes ainsi que les principes de sécularisation en Tunisie ne seront pas remis en cause. A la suite de débats intenses, tant en interne qu’au sein de l’Assemblée Nationale Constituante, une constitution de compromis comprenant des dispositions ambigües et contradictoires entre deux conceptions opposées de l’Etat, l’une séculariste et l’autre islamo-conservatrice est adoptée le 26 janvier 2014.
Le développement de la violence politique avec l’assassinat de deux députés de gauche, les actions musclées des Ligues de Protection de la Révolution, majoritairement investies par des militants d’Ennahda, les positions très conservatrices prises par certains de ses dirigeants, la conjoncture internationale avec le soutien occidental au coup d’Etat ayant renversé en Egypte les Frères Musulmans au pouvoir et le marasme dans lequel est plongée l’économie finit toutefois par discréditer Ennahda qui se retire du pouvoir en faveur d’un gouvernement de technocrates. En 2014, les élections présidentielles sont remportées par Beji Caïd Essebssi, ancien ministre sous l’ère d’Habib Bourguiba. A la suite du décès du président Béji Caïd Essebsi en 2019, un double scrutin législatif et présidentiel est organisé cette année là. Les élections législatives aboutissent à une assemblée fragmentée entre diverses formations et l'élection présidentielle propulse à la tête de l'État un nouveau venu dans le monde politique, un juriste et universitaire spécialiste du droit constitutionnel, Kaïs Saïed,
Dynamique de la présence historique de l’islam dans le pays :
Avant l’arrivée des Arabes au VIIe siècle, Carthage et le territoire de l’actuelle Tunisie était peuplé de populations principalement chrétiennes qui coexistaient avec des tribus berbères, juives ou païennes.
Avec la conquête arabe, l’ensemble de la population s’est progressivement convertie à l’islam, notamment les tribus berbères vivant à l’intérieur des terres. Ce phénomène s’est développé de manière progressive provoquant des résistances, des apostasies ponctuelles ou des formes de syncrétismes. En effet, nombreux sont ceux qui rejetèrent le Sunnisme dominant, voire le chiisme sous le califat fatimide (établi en Tunisie de 909 à 969) et adhérèrent au Kharidjisme. Apparu en Arabie en 657 lors de la bataille de Siffin, il constitue aux côtés du sunnisme et du chiisme la troisième branche de l’islam et la moins importante en nombre de fidèles. Il s’est développé au Maghreb lors des insurrections berbères de 739-743. Ses adeptes développent une pratique religieuse teintée d’un fort rigorisme moral, condamnent les privilèges et prônent une égalité entre les fidèles.
La Tunisie fut un important centre de production culturelle islamique à l’époque médiévale. La cité de Kairouan, érigée en capitale sous la dynastie des Aghlabides (800-909) ainsi que la mosquée-université de la Zîtûna, édifiée en 703 à Tunis, devient un important centre d’apprentissage et de diffusion de la théologie et du droit dans le monde musulman.
A l’exception d’une minorité ibadite, un courant de l’islam rattaché au Kharidjisme, principalement implanté chez les
populations berbérophones de l’île de Djerba, la majorité de la population tunisienne est Sunnite de rite malékite, à l’exception d’une communauté hanafite d’origine ottomane. La diffusion de l’islam sunnite est largement le fait des conquêtes omeyyades. La Grande mosquée de Kairouan constitua un important centre d’enseignement de la jurisprudence malékite, qu’elle contribua à diffuser dans la région.
A partir du XIXe siècle, l’élite tunisienne a été fortement influencée par les courants politiques et intellectuels européens, ce qui a eu des conséquences sur la conception et la gestion de l’islam mise en œuvre à partir de l’indépendance le 20 mars 1956. Marqué par les idées rationalistes et positivistes d’Auguste Comte, Habib Bourguiba, le premier président de la république tunisienne était adepte d’une sécularisation autoritaire. Dès l’indépendance de la Tunisie en 1956, il s’est autoproclamé mujtahid, c’est-à-dire « interprète » de la Loi religieuse, allant jusqu’à intimer l’ordre aux fidèles de rompre le jeune en plein mois de ramadân, imposant des réformes juridiques dont certaines sont demeurées encore aujourd’hui sans équivalent dans le monde arabo-musulman (cf. supra). Afin de contrer l’influence grandissante de l’islamisme politique dans la population, il renforce à partir des années 1980 le contrôle autoritaire de l’islam en instaurant la désignation du personnel des mosquées (imâm, muʾaḏhḏhin –muezzin-, chargés d’entretien) directement par l’Etat afin de contrôler leurs activités et les propos tenus devant les fidèles. Cette politique est poursuivie par son successeur Zine el Abidine Ben Ali.
En 1988, tous les regroupements ou activités dans les mosquées sont interdits s’ils ne sont pas menés par des représentants nommés par l’Etat. Le contrôle autoritaire de l’islam se délite après la Révolution de 2011, la diminution de la répression policière permettant un regain de la pratique religieuse contrôlée, voire réprimée depuis des années. Celle-ci s’accompagne parfois d’une accentuation du conservatisme religieux. En 2017, plusieurs individus ont été arrêtés par la police et jugés pour avoir rompu le jeûne du ramadân en public, alors même que la loi ne l’interdit pas. Ceci traduit également l’émergence dans certaines franges minoritaires de la population, d’une individualisation des pratiques religieuses, voire de l’abandon de toute pratique religieuse, même si l’athéisme reste encore très largement tabou.
Depuis 2014, alors que certaines mosquées étaient passées sous l’influence d’imams radicaux, le ministère des Affaires religieuses a repris le contrôle des mosquées tunisiennes, mais le contenu des services proposés par les imams n’est plus placé sous la surveillance du gouvernement. Les tunisiennes peuvent épouser des hommes non-musulmans depuis 2017, cette mesure ne semblant pas appliquée de manière uniforme sur tout le territoire.
Néanmoins, malgré une sécularisation autoritaire menée depuis l’indépendance, de manière beaucoup plus marquée que dans la plupart des autres pays arabes, l’Islam demeure une valeur identitaire centrale pour une grande majorité de la population.
Constitution et religions, Constitution et Islam :
Le Préambule de la Constitution tunisienne de 2014 définit le peuple tunisien comme étant d’identité arabe et musulmane.
L’article 1er ainsi libellé « La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l’Islam est sa religion, l’arabe sa langue et la République son régime. Le présent article ne peut faire l’objet de révision » fait l’objet de deux interprétations : la première visant à considérer que l’islam est la religion de l’Etat tunisien, la seconde que si la majorité du peuple tunisien est musulman, l’État ne l’est pas forcément. Toutefois, l’« islamité » du Chef de l’Etat est consacrée par l’article 74 al 1er de la constitution ainsi libellé : « La candidature à la présidence de la République est un droit pour toute électrice et pour tout électeur jouissant de la nationalité tunisienne par la naissance, et étant de confession musulmane ».
L’Etat tunisien reconnait cependant le libre exercice des cultes Comme stipulé dans l’article 6 de la Constitution tunisienne : « L’État protège la religion, garantit la liberté de croyance, de conscience et de l’exercice des cultes. Il assure la neutralité des mosquées et des lieux de culte de l’exploitation partisane ». Selon le même article, l’Etat s’engage à diffuser les valeurs de modération et de tolérance et à protéger le sacré et empêcher qu’on y porte atteinte. Il s’engage également à prohiber et empêcher les accusations d’apostasie [takfîr], ainsi que l’incitation à la haine et à la violence et à les juguler.
Le Gouvernement exerce une supervision plus ou moins limitée sur l’exercice du culte musulman. La constitution tunisienne prévoit, dans son article 70 que le Président de la République désigne un Mufti, qui représente la plus haute autorité religieuse du pays.
Depuis 1957, une direction du culte est rattachée au Premier Ministre, qui exerce un contrôle sur les mosquées du pays. Celle-ci est transformée en un secrétariat d’Etat en 1989, puis est érigée en ministère des Affaires Religieuses par la suite. Ce dernier est mandaté pour l’exécution de la politique religieuse du gouvernement et encadre l’exercice du culte
musulman dans le pays.
Si l’Islam est majoritaire en Tunisie, d’autres religions sont également pratiquées. Les minorités religieuses comprennent une communauté juive et chrétienne. La communauté juive, estimée à plus de 100 000 personnes en 1948, est réduite à quelque 1000 individus aujourd’hui, qui vivent principalement à Djerba et à Tunis.
En 1964, un Modus Vivendi a été signé entre le Saint Siège et le Gouvernement tunisien. Cet accord reconnait l’Eglise catholique en Tunisie et l’autorise à exercer ses activités dans le pays. Une liste définie d’établissements scolaires et hospitaliers appartenant à des associations religieuses sont garantie du libre exercice de leurs activités dans les limites de la loi.
Système juridique et judiciaire (grandes lignes) :
Le système juridique tunisien s'inspire principalement du droit français (Code des obligations et des contrats, Code des douanes, Code de la justice militaire, Code de procédure civile et commerciale, Code électoral, etc.). A l’indépendance du pays en 1956, les tribunaux religieux (shar‘) compétents à l’époque beylicale et du Protectorat pour statuer sur les questions relatives au statut personnel et successoral et à la propriété immobilière, sont supprimés. Néanmoins le Code du statut personnel reste influencé par la tradition juridique islamique.
La Constitution de 2014 réitère le principe d’indépendance de la justice. Le pouvoir judiciaire tunisien est exercé par des juridictions de droit commun ainsi que par des juridictions spécialisées et d’exception. Les juridictions civiles, pénales, commerciales et administratives appartiennent au même ordre, avec à son sommet la Cour de cassation qui est la plus haute instance judiciaire. La Cour constitutionnelle contrôle la constitutionalité des projets de loi, traités et règlement de l’Assemblée des représentants. A ce jour, elle n’a pas été mise en place.
Droit de la famille (grandes lignes, textes principaux) :
Le droit de la famille est régi en Tunisie par le Code du statut personnel (CSP) qui a été promulgué en 1956, avant même la proclamation de la République en 1957 et l’adoption de la Constitution en 1959, ce qui traduit l’importance qui lui est donnée par le nouveau gouvernement dirigé par H. Bourguiba.
Parmi ses dispositions les plus emblématiques, on trouve l’interdiction de la polygamie sous peine de prison (art. 18), ainsi que l’autorisation accordée aux femmes d’entreprendre une procédure judicaire afin de divorcer (art. 31). Le divorce est permis à la simple demande de l’un ou l’autre époux ou en cas de préjudice causé par l’un ou l’autre (talâq al-darar), ce qui permet au demandeur de requérir des dommages et intérêts.
Le CSP a connu de nombreuses modifications qui ont renforcé l’égalité entre les femmes et les hommes. Ainsi, à titre d’exemple, la loi du 12 juillet 1993 a supprimé l’obligation faite aux femmes d’obéir à leur mari, et a instauré une relation conjugale fondée sur “la coopération, dans la bienveillance… et le respect des devoirs conjugaux conformément aux usages et à la coutume”.
Cependant, ces réformes se sont heurtées à une pratique judiciaire restée assez fortement conservatrice. Malgré sa réputation visant à établir l’égalité entre les genres, la pratique peut s’avérer très différente. Les critiques concernent notamment l’application du droit de la famille qui serait marquée par la coexistence de deux approches antagonistes du droit au sein même des tribunaux.
En 2017, le Président Béji Caïd Essebssi instaure la Commission des libertés individuelles et de l’égalité (Colibe). Celle-ci est chargée de préparer un rapport concernant les libertés individuelles et l’égalité conformément à la Constitution de 2014 et aux engagements internationaux de la Tunisie en matière des droits humains. Certaines des propositions de la Colibe, rendues publiques en juin 2018, touchent directement au droit de la famille. Elles concernent notamment l’égalité entre les femmes et les hommes en matière d’héritage, l’égalité dans l’attribution de la nationalité et du choix de nom de la famille et l’abolition de l’article 230 du Code pénal criminalisant des pratiques homosexuelles.
Droit de la sexualité (relations hors-mariage, homosexualité, pédophilie, viol, avortement, etc.) :
En Tunisie, les relations hommes-femmes sont régies par un ensemble de normes issues du droit de la famille et du Code pénal plus ou moins précise, ce qui laisse une très grande marge d’interprétation aux juges. Par exemple, l’article 226 du Code pénal prévoit « qu’est puni de six mois d'emprisonnement et de quarante-huit dinar d'amende, quiconque sera, sciemment, rendu coupable d'outrage public à la pudeur » mais la notion « d’outrage public à la pudeur » est sujette à interprétation.
Les relations sexuelles hors mariage peuvent être considérées comme illégales si l’on se réfère à la loi n° 57-3 du 1er août 1957 réglementant l’état-civil promulgué après le Code du statut personnel, qui dans son article 36 précise : « l’union qui n’est pas conclue conformément à l’article 31 (acte de mariage) est nulle. Les deux époux sont passibles d’une peine de trois mois d’emprisonnement. Les époux, dont l’union a été déclarée nulle et qui continuent ou reprennent la vie commune, sont passibles d’une peine de six mois d’emprisonnement ».
L'article 236 du Code pénal tunisien dispose que « L'adultère du mari ou de la femme est puni d'un emprisonnement de cinq années et d'une amende de 500 dinars. Il ne peut être poursuivi qu'à la demande de l'autre conjoint qui reste maître d'arrêter les poursuites ou l'effet de la condamnation. Lorsque l'adultère est commis au domicile conjugal, l'article 53 du présent code ne sera pas applicable. Le complice est puni des mêmes peines que la femme ou le mari coupable ».
Le concubinage n’est pas autorisé et si les relations hors mariage ne sont pas explicitement interdites, un jugement est venu condamner en 2018 d’une peine de six mois de prison avec sursis assortie d’une amende un lycéen qui avait été surpris en train d’embrasser une lycéenne dans l’enceinte d’un lycée.
S’agissant des relations entre individus de même sexe, le Code pénal tunisien incrimine l’homosexualité féminine et masculine. Dans son article 230, le Code pénal tunisien incrimine la sodomie : « La sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas prévus aux articles précédents, est punie de l'emprisonnement pendant trois ans ». Néanmoins, la version arabe du même article, qui fait juridiquement foi, traduit la sodomie par liwât indiquant donc que l’incrimination concerne tant l’homosexualité masculine et féminine. D’un point de vue plus général, les pratiques homosexuelles font encore l’objet d’un fort opprobre social et sont sanctionnées par la justice.
L’article 228 du Code pénal dispose que l’auteur d’un rapport sexuel non consenti sur un mineur encourt jusqu’à douze ans de prison, voire un emprisonnement à perpétuité dans certaines circonstances. Cependant, les tribunaux sont très rarement saisis de plaintes déposées à ce propos, ce genre de sujet , tout comme le viol, constituant encore un tabou dans la société tunisienne.
Bibliographie indicative :
Hached, Farah : « La laïcité : un principe à l'ordre du jour de la IIe République tunisienne ? », Confluences Méditerranée, vol. 77, no. 2, 2011.
Laghmani, Slim : ”Droit musulman et droit positif : le cas tunisien » In : Politiques législatives : Égypte, Tunisie, Algérie, Maroc [en ligne]. Le Caire : CEDEJ- Égypte/Soudan, 1994.
MaaikeVoorhoeve : « Production judiciaire des normes et vigilance de la société civile : Le cas de la sexualité en Tunisie », L’Année du Maghreb,2017.
Mokhlefi, Mansouria. « Tunisie : Islamisation, Islam et islamisme » In Kathala : Histoire, monde et culture religieuses, vol. 2 no. 34, 2015
Ben Achour, Sana : « Le Code tunisien du statut personnel, 50 ans après : les dimensions de l’ambivalence », L’Année du Maghreb,2007.
Ben Achour, Yadh. « Politique et religion en Tunisie » Confluences Méditerranée n° 33(2000)