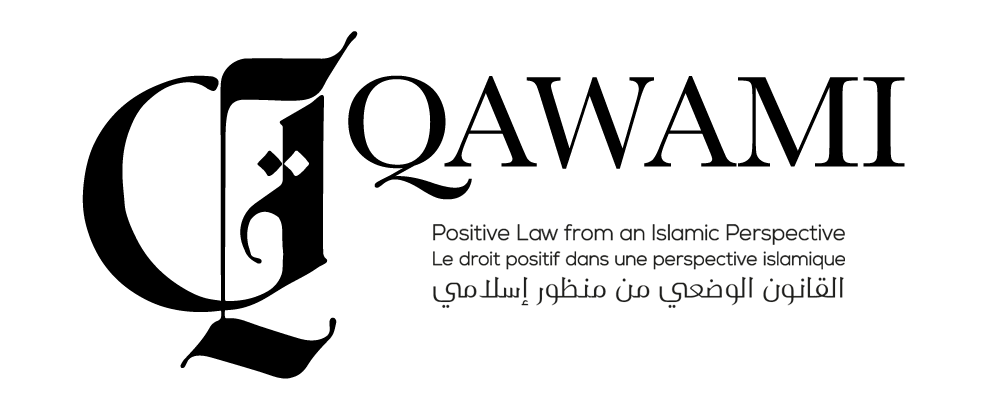Etat de l’art
Les régulations normatives sont inhérentes à la gestion des collectifs humains. Avec la « modernité », leur pertinence par rapport à l’ordre naturel des choses – c’est-à-dire par rapport aux « lois de la nature » et tout ce qui peut s’y rattacher – est devenu un élément essentiel de leur justification. Il en a découlé l’entrée de la science des lois dans la nomenclature de L’Encyclopédie et son articulation avec les sciences de la nature et, par conséquent, sa soumission à une même conception du juste et du vrai (Boudon, 1995). Cela s’est traduit par une positivisation formelle des systèmes de normes et leur articulation avec le positivisme des nombres. En un mot, l’un et l’autre participent de la même épistémè.
En contexte musulman, le contact ou la confrontation avec la modernité d’inspiration européenne a conduit au bouleversement des systèmes normatifs islamique et coutumier, qui se sont transformés en un système de droit positif de type civiliste, le plus souvent, en un système de common law sinon (Brown, 1997). Dans certaines matières spécifiques, spécialement dans le domaine de la famille, l’ancienne normativité islamique s’est muée en un droit positif musulman (Buskens et Dupret, 2011).
Plus récemment, de nouvelles formes de normativités ont émergé, sous l’influence de la globalisation des modes de gouvernance et, en particulier, de la généralisation de l’usage des normes managériales (Coste, 2019, Yakin, à paraître). Le recours à ces normes, qui prend la forme d’indicateurs et de standards, survient en complément ou en conflit avec les règles juridiques positives, dans un mouvement tendant à la densification, voire à l’hyper-densification normative des sociétés contemporaines. Ce phénomène touche l’ensemble des secteurs sociaux, y compris ceux qui sont encore régis, à des degrés variés, par la normativité islamique. Ces indicateurs sont aussi utilisés pour assurer la gouvernance sécuritaire, sanitaire et environnementale.
La positivisation est le processus par lequel une certaine conception du monde, fondée sur l’idée que celui-ci est constitué par un ensemble de faits scientifiquement objectivables, s’impose comme mode de description du monde et des sociétés, et, partant, des actions nécessaires à leur gouvernance (Brunon-Ernst, 2014). La positivisation du regard sur les sociétés africaines s’observe à deux niveaux, tous domaines confondus : celui de la représentation et celui de l’intervention (Hacking, 1983). Le premier de ceux-ci se situe dans la production et l’accumulation d’un savoir métrologique, scientifique et technocratique considérable, aux niveaux international, régional, national et local (Breen, 2008). Que ce soit par le biais des Nations-Unies, des diverses coopérations multilatérales et bilatérales, des agences étatiques, des ONG et des acteurs associatifs et économiques, mais aussi des multiples institutions académiques, dans leurs compétences disciplinaires et aréales, les « données » collectées sur les sociétés contemporaines et leurs transformations sont considérables, sans qu’on ne puisse pour autant préjuger de leur qualité, utilité et usage. Le deuxième niveau de positivisation s’observe dans le recours à ces « données », parfois devenues « big data », pour conduire des politiques d’intervention économique, sociale, culturelle et autre (Desrosières, 2014). La positivisation porte particulièrement sur les normes, un terme qui, dans son sens générique, doit être entendu dans un double sens descriptif et statistique (comme quand on dit que tel comportement constitue la norme d’une société), d’une part, prescriptif et normatif (quand il désigne une chose qui « doit être », un « ought to be »), de l’autre (Lochak, 1984). Ces normes visent tout particulièrement à déterminer et régler les dysfonctionnements ainsi qu’à faire face aux crises en disposant de guides considérés comme sûrs dans ces phases d’incertitudes. Par l’entremise de textes constitutionnels, législatifs et réglementaires, mais aussi de schèmes directeurs, de standards et de normes diverses, dont beaucoup relèvent de la métrique, les autorités entreprennent de réguler le fonctionnement des sociétés et des écosystèmes dans lesquels elles sont insérées. La particularité de cette régulation est, toutefois, (a) que les instruments qui la permettent et l’orientent sont ceux-là mêmes qui déterminent son existence (Canguilhem, 2010) et (b) que, si les métriques et les standards sont exclusifs d’autres métriques et d’autres standards, il n’en demeura pas moins que plusieurs métriques et plusieurs standards sont simultanément disponibles et donc débattables, bien qu’ils visent à échapper au débat en s’imposant d’eux-mêmes.
Les crises sécuritaires, sanitaires et environnementales mettent particulièrement en tension les jeux de normes, de mesures et de standards, alors qu’elles ont besoin, plus que d’autres situations, de repères assurés pour agir et apaiser. La crise liée à la pandémie du Covid-19 en offre un exemple frappant : les normes, les mesures et les standards sont au centre des politiques publiques destinées à lutter contre la pandémie (normes épidémiologiques, normes juridiques liées au confinement, normes éthiques dans la définition des traitements, etc.) et en même temps ne semblent pas à même de résorber l’incertitude. On assiste, au contraire, à des jeux métrologiques dérégulés, comme en témoigne la tendance de plus en plus marquée à se référer à la valeur absolue des nombres plutôt qu’à leur valeur relative, c’est-à-dire contextualisée. On parle ainsi de plusieurs « centaines » de morts comme si ce nombre était par lui-même probant. Inversement, si l’on songe au débat sur le changement climatique et à l’abondance des mesures qui s’y rapportent (notamment celles produites par le GIEC-IPCC), le caractère probant des standards chiffrables apparaît paradoxalement dénué d’effectivité, puisque les mesures et les projections des experts ne parviennent pas à infléchir significativement les attitudes et les conduites des parties prenantes.
La positivisation juridique correspond à l’élaboration intentionnelle et délibérée de normes systémiquement articulées les unes aux autres, adossées à un pouvoir souverain prenant la figure de l’Etat, constitutives du « devoir-être » social et auto-référencées (Luhmann, 2004, Murphy, 2005, Dupret, forthcoming). Cela correspond au passage à une normativité juridique conçue comme instrument d’ingénierie sociale, qu’il faut en conséquence construire. La positivisation du droit est un phénomène global, en ce sens qu’elle s’est étendue progressivement à l’échelle planétaire. Elle a en même temps opéré à des rythmes propres et selon des modalités particulières à chaque société, et ses formes de traduction locale sont extrêmement variées (Halpérin, 2014).
La positivisation normative s’entend de la tendance à l’élaboration de normes permettant l’orientation, la coordination et l’évaluation de l’action. Elle prend la forme d’indicateurs établissant des situations factuelles sur la base critères quantifiables et de standards spécifiant des niveaux à atteindre et des modèles auxquels se conformer. Indicateurs et standards relèvent d’un processus de normalisation, c’est-à-dire d’une mise en adéquation d’objets (p.ex. les télécommunications). Le processus s’est étendu aujourd’hui à toute l’économie et au domaine des services, par le biais tout particulièrement du contrôle qualité. Problème technique, la normalisation a aussi des implications économiques (nouvelles parts de marché) et sociétales (concurrence de modèles de société). L’élaboration des normes échappe ici au modèle classique de la volonté du souverain (le législateur) et relève davantage des besoins de la coordination technique, économique et sociétale. Ces normes comportent néanmoins une véritable force normative : le glissement d’une nature indicative (un état de fait, un ajustement métrique ; Desrosières, 2010) à une nature prescriptive (une nécessité, un objectif à atteindre). L’adoption de normes techniques implique un choix politique, des contraintes et des conséquences prescriptives (Frydman, 2014).
La standardisation est le processus par lequel des objets, technologiques d’abord, managériaux ensuite, sont normalisés, c’est-à-dire alignés sur des paramètres identiques permettant leur appariement, leur combinaison, leur articulation et leur comparaison (Frydman, 2014). La standardisation concerne les normes techniques (dans le domaine ferroviaire, par exemple), les normes juridiques (au niveau des différents droits des pays de l’Union européenne, par exemple ; Boisson, 2014) , les pratiques judiciaires (le respect des critères du procès équitable, par exemple ; Piana, 2014), et la gouvernance (par exemple, les critères de l’Etat de droit, dans l’administration de la justice entre autre ; Restrepo, 2014). La standardisation normative concerne des normes qui se construisent « bottom-up », sans être la résultante de la volonté du souverain (théorie positiviste classique). Les normes se présentent alors comme une réponse à un problème de coordination de l’action et non comme la manifestation d’une volonté d’ingénierie sociale. Ce type de normes se consolide par leur capacité à instituer des pratiques et à servir d’instrument aux actions (Frydman, 2014). Cette schématisation du haut vers le bas est toutefois contrastée, selon qu’il s’agit des opérateurs internationaux ou des communautés locales, qui peuvent anticiper sur des questions de gouvernance, court-circuiter les gouvernements, voire obtenir que des pressions soient exercées par les bailleurs internationaux pour infléchir la loi vers d’autres normes.
La densification normative (Thibierge, 2014) est l’expression par laquelle on désigne un phénomène propre aux normes juridiques (tendance au recours toujours accru à la régulation juridique et judiciaire des rapports sociaux ; voir Brunet, 2014, Dourneaux, 2014, Robineau, 2014) aussi bien qu’aux normes techniques. Dans le premier cas, cela vise la tendance à la juridicisation des sociétés contemporaines, c’est-à-dire au recours toujours accru à la régulation juridique et judiciaire des rapports sociaux.. Dans le second cas, la densification normative concerne la positivisation normative évoquée au paragraphe précédent et à l’extension de celle-ci, au-delà des seuls standards techniques à l’ensemble des secteurs de la vie en société, y compris celui de services tels que la justice (Dubost, 2014).
Différents indicateurs sont utilisés aujourd’hui, par les agences et organisations nationales, régionales, bilatérales et multilatérales, pour assurer la gouvernance des sociétés, à commencer par la gouvernance sécuritaire (Breen, 2008). L’indicateur Rule of Law de la Banque Mondiale en est un bon exemple (Restrepo, 2014). Le développement de celui-ci répond à distance au virage juridique de cette organisation, quand elle a décidé que le droit n’était pas qu’un instrument de réforme économique, mais aussi un objectif de développement. En même temps, on peut observer le recours croissant à une méthodologie quantitative pour chiffrer la qualité et la performance des systèmes juridiques nationaux (Breen, 2002). Sous l’expression « Etat de droit / Rule of Law », de nouvelles attentes normatives sont fixées dans le domaine de l’aide au développement, entre une gouvernance qui libéralise la régulation et une activité économique qui nécessite un minimum de standards normatifs pour se développer au niveau transnational. Le recours aux indicateurs se justifie, aux yeux des opérateurs internationaux, par l’importance de la gouvernance pour le développement, la nécessité de rendre les analyses objectives et comparables et la nécessité de tendre vers une standardisation du corpus iuris des Etats. Ces indicateurs s’étendent à des questions telles que la qualité de la force exécutoire des contrats, la qualité des droits de propriété, la qualité de la police et des tribunaux et le risque de criminalité et de violence. Les indicateurs mesurent la question de l’Etat de droit, mais aussi celles de la justice, de la corruption, de la démocratie, etc. (Breen, 2008). En Afrique du Nord et de l’Ouest, ces questions sont étudiées dans la perspective d’une distinction entre politique classique et technocratie (Niane, 2011, Diouf, 1992, Coumba Diop, 2004).
La gouvernance sécuritaire est le concept par lequel on cherche à rendre compte du processus de coordination d’acteurs, groupes sociaux et institutions en vue d’atteindre des objectifs de sécurité qui, dans les sociétés modernes, relèvent de la responsabilité conjointe de l’État et d’une multitude d’acteurs publics, privés et hybrides. La gouvernance sécuritaire est devenue un enjeu social majeur de la « société du risque » (Augé, 2006) : gestion des conflits armés, sous-traitance mercenariale, contre-terrorisme, agents de sécurité dans les espaces publics ou privés recevant du public, commercialisation de services policiers à des autorités parapubliques ou à des intérêts privés, échanges de données et de renseignements criminels entre acteurs publics et privés. Cela vaut pour les sociétés du nord comme du sud, mais selon des modalités et des priorités parfois très différentes.
La gouvernance de la santé apparaît tout particulièrement soumise à la positivisation du fait de sa forte articulation aux pratiques scientifiques et aux considérations éthiques. La place de la métrique apparaît notamment dans les domaines de la santé publique et de l’épidémiologie, puisque ces deux domaines allient les comptages et dénombrements ordinaires de la population, propres à toute politique publique, aux comptages et dénombrements spécifiques liés à la diffusion des agents infectieux et des pathologies. Lors des situations de crise, ces procédures se trouvent intégrées dans des mesures d’ordre public caractéristiques du gouvernement de l’urgence, lesquelles sont prises par des autorités politiques. La gouvernance de l’urgence sanitaire met en branle un jeu complexe de normes et de standards, lesquels doivent, en outre, composer avec les normes religieuses dans bien des cas. La fermeture des mosquées comme les règles s’imposant lors des funérailles en sont exemple frappant. Des choix de valeurs, de mesures ou de procédures sont inévitablement à la fois nécessaires et affectés par des critères exogènes. Ces chevauchements contribuent à augmenter l’incertitude et la discutabilité des politiques adoptées, de même que l’anticipation de ces conséquences de court terme influence immanquablement les choix opérés par les autorité publiques.
La gouvernance environnementale et climatique combine un foisonnement des normes, des comptages et des standards avec une situation de stress à moyen et à long terme, des méthodes et procédures permettant de chiffrer les risques, et l’élaboration de modèles prédictifs. Ceux-ci n’acquièrent toutefois pas nécessairement et avec rapidité un statut prescriptif, ce qui a un impact direct sur les mesures prises et à prendre. Il en résulte aussi la nécessité d’ajustements entre différents domaines de comptage et de normativité, mais, plus encore que pour les crises sanitaires, cela s’inscrit dans un « mix intérieur-extérieur », ces deux dimensions se soutenant ou se desservant mutuellement, comme le montrèrent successivement, et de manière contrastée, la COP 21 (Paris) et la COP 22 (Marrakech). Enfin, il importe de tenir compte de la production juridique concernant les biens communs, dont l’usage relève parfois de conventions et de coutumes, dont la positivisation n’est que partielle, et de leur articulation avec les normes positives édictées par les Etats.